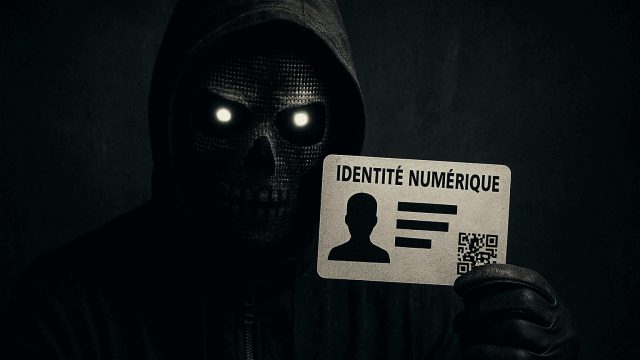Alors que les gouvernements européens vantent les mérites de l’identité numérique comme une solution de simplification administrative, la réalité est tout autre : derrière cette innovation apparente se cache un système de contrôle systémique, centralisé, permanent et potentiellement autoritaire.
L’identité numérique impose à chaque citoyen une identification numérique obligatoire pour accéder à ses droits fondamentaux : services publics, santé, finances, voire même simples achats à terme. Ce dispositif ouvre la voie à une société de surveillance algorithmique, contraire aux principes démocratiques.
1. Qu’est-ce que l’identité numérique ?
L’identité numérique est une interface numérique centralisée attribuée à chaque individu, utilisée pour prouver son identité en ligne ou dans des systèmes connectés. Si elle peut sembler anodine (ex. : France Identité, eID en Europe), ses implications profondes soulèvent des enjeux majeurs de liberté individuelle :
Centralisation des données personnelles (état civil, biométrie, historique médical, fiscal, social…)
Traçabilité permanente des actions en ligne et hors ligne
Conditionnement de l’accès aux services à la validation d’identité
Interopérabilité entre bases de données étatiques et privées
Risque de profilage automatisé et de scores sociaux implicites
2. Atteintes légales et constitutionnelles de l’identité numérique
L’imposition d’une identité numérique enfreint plusieurs normes juridiques fondamentales, à l’échelle française et européenne.
A. Violation du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)
Le RGPD impose des principes clairs en matière de traitement des données personnelles :
Consentement libre et éclairé
Finalité spécifique et légitime
Minimisation des données collectées
Droit à l’anonymat, à l’effacement et à l’opposition
➡️ Problème : Une identité numérique imposée pour accéder à des services essentiels constitue une forme de chantage au consentement. De plus, la centralisation biométrique ou comportementale viole les principes de minimisation.
Recours :
Plainte à la CNIL
Saisine des autorités nationales de protection des données
Recours devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
B. Atteinte à la Charte des droits fondamentaux de l’UE
Articles concernés :
Article 7 : Respect de la vie privée
Article 8 : Protection des données à caractère personnel
Article 21 : Non-discrimination
Article 52 : Proportionnalité des atteintes aux droits
➡️ Problème : L’exclusion ou la discrimination de citoyens non-connectés ou refusant une identité numérique constitue une atteinte directe aux droits fondamentaux.
Recours :
Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
Recours préjudiciel devant la CJUE
Saisine du Médiateur européen
C. Violation de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)
L’article 8 de la CEDH protège la vie privée et la confidentialité des données.
➡️ Problème : Une identité numérique interconnectée à tous les registres publics permet un suivi massif de la population. Cela pourrait être assimilé à une surveillance étatique illégitime.
Recours :
Recours devant la Cour européenne des droits de l’homme
Actions coordonnées avec des ONG spécialisées (ex. : Privacy International, La Quadrature du Net)
D. Infractions pénales potentielles (Code pénal français)
Les porteurs et exécutants d’un projet d’identité numérique obligatoire pourraient être poursuivis pour :
Atteinte à la vie privée (articles 226-1 à 226-4)
Abus de pouvoir (article 432-1 et suivants)
Collecte illicite de données (articles 226-16 à 226-24)
Discrimination (articles 225-1 à 225-2)
Recours :
Plainte nominative contre décideurs publics ou entreprises partenaires (éditeurs logiciels, opérateurs techniques)
Dépôt de plainte collective ou individuelle en droit pénal
Constitution de partie civile via association
3. Qui peut être tenu juridiquement responsable ?
| Catégorie | Responsabilité | Recours envisageables |
|---|---|---|
| Responsables politiques | Auteurs ou soutiens du projet sans débat public ni évaluation d’impact | QPC, plainte pénale |
| Administrations publiques | Déploiement ou soutien actif à l’identité numérique sans base légale claire | Recours administratif |
| Autorités de régulation | Inaction face aux dérives (ex : CNIL, Défenseur des Droits) | Saisine officielle, recours hiérarchique |
| Entreprises partenaires | Développement ou hébergement sans garanties juridiques (biométrie, données sensibles) | Plainte CNIL, action civile pour préjudice |
| BCE / Commission européenne | En cas de lien avec l’identité numérique européenne interopérable | Recours CJUE, pétition parlement européen |
4. Actions concrètes que tout citoyen peut engager
| Action | Base légale | But |
|---|---|---|
| Saisir la CNIL | RGPD | Contester la collecte/usage des données liées à l’identité numérique |
| Déposer une QPC | Constitution | Faire reconnaître l’inconstitutionnalité d’une obligation numérique |
| Saisir la CEDH | Article 8 | Contester la surveillance par traçabilité numérique |
| Lancer une action collective | Droit civil ou pénal | Réunir des citoyens pour contester le projet devant les juridictions |
| Pétition / Plaidoyer parlementaire | Droit européen | Faire pression pour bloquer l’interopérabilité européenne obligatoire |
L’identité numérique n’est pas qu’un outil administratif. C’est un pivot stratégique dans la transformation numérique du pouvoir, avec des conséquences profondes sur la vie privée, les droits fondamentaux et le contrôle citoyen.
Mais ce projet n’est ni inévitable, ni invulnérable. Il existe des textes juridiques puissants, des instances de recours, et une mobilisation citoyenne croissante.
Protéger nos libertés commence par :
Refuser de céder ses données biométriques ou de s’inscrire par défaut
Interpeller les élus locaux et européens
S’unir en associations de défense des droits numériques
Saisir les autorités compétentes : CNIL, Défenseur des droits, juridictions nationales et européennes
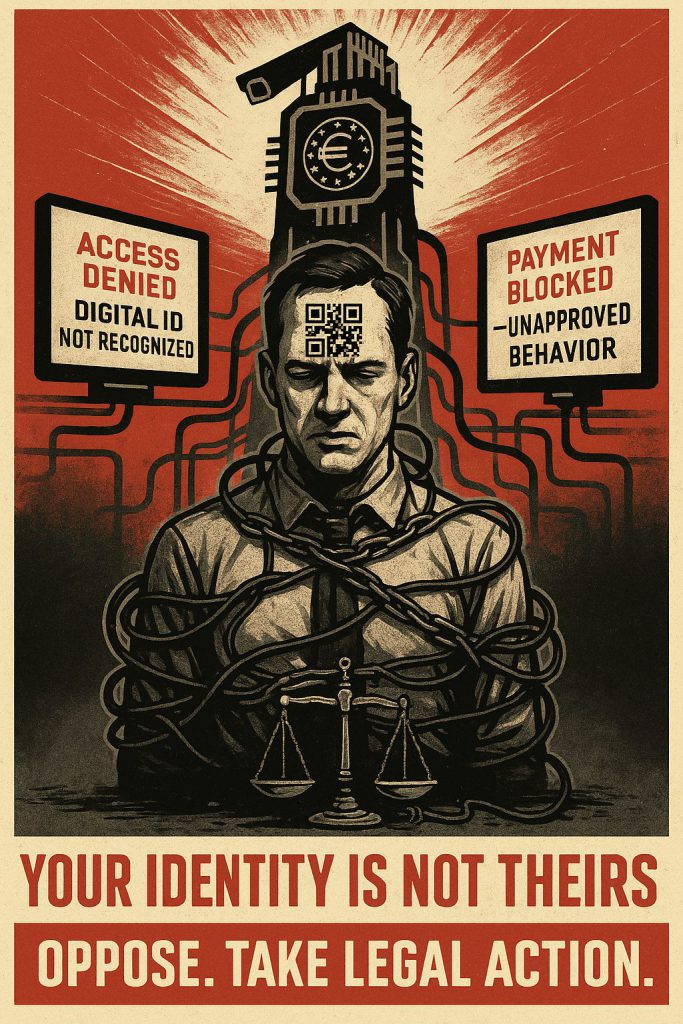
L’avenir numérique peut être libre – à condition de ne pas le déléguer à ceux qui veulent le centraliser.